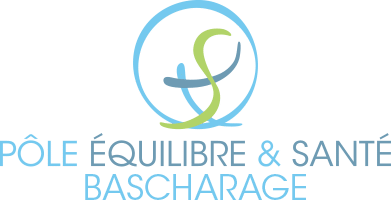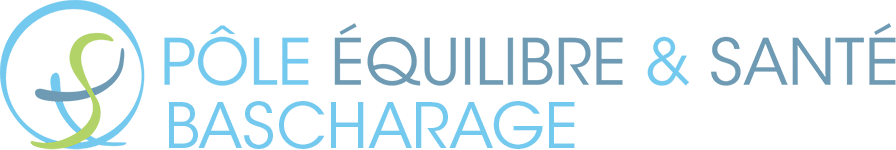Rééducation Vestibulaire Bascharage

Les canaux semi-circulaires détectent l’amplitude de la rotation angulaire de la tête dans les trois dimensions de l’espace. Les organes otolithiques sont eux sensibles à l’accélération linéaire verticale (saccule) ou horizontale (utricule) de la tête dans l’espace et détectent l’inclinaison de celle-ci par rapport à la gravité.
Ces noyaux reçoivent outre les entrées vestibulaires, des entrées visuelles et proprioceptives. Les noyaux vestibulaires ne sont donc pas de simples relais de l’information issue de l’oreille interne mais de véritables centres d’intégration sensori-motrice. Les neurones vestibulaires centraux se projettent ensuite au niveau des noyaux oculomoteurs pour la stabilisation du regard ou au niveau de la moelle pour la stabilisation de la posture.
La rééducation vestibulaire
La rééducation vestibulaire est une spécialité de la kinésithérapie qui va permettre de soulager les patients souffrant de pathologies du système vestibulaire parmi lesquels on retrouve :
- Les affections du Système Nerveux Central
- Les troubles de l’équilibre
- Les troubles de la marche
- L’oreille interne
Ces différentes pathologies se manifestent par des sensations de vertiges (rotatoires, linéaires, déséquilibre ou encore des oscillopsies).
En médecine, le terme vertige désigne une illusion de mouvement, le plus souvent rotatoire, que l’on peut comparer à celle que l’on ressent après avoir tourné rapidement dans un carrousel, et résulte d’une asymétrie d’activité des noyaux vestibulaires gauches et droits. En pathologie, il traduit un dysfonctionnement du système vestibulaire. Dans le langage courant, les patients utilisent souvent le mot vertige pour désigner toute instabilité. Mais attention, le terme vertige doit être distingué de la notion d’instabilité (manque d’équilibre). Ces vertiges sont généralement associés à des nausées, des vomissements ou autres chutes.
Suivant la pathologie diagnostiquée, la manœuvre libératoire sera effectuée afin de traiter les crises. Divers conseils et exercices seront également donnés au patient et par la suite une rééducation sera mise en place pour éviter les rechutes.
Pour répondre au mieux à vos attentes en kinésithérapie vestibulaire, notre cabinet Pôle Équilibre & Santé de Bascharage s’est équipé de la vidéo-nystagmoscopie (outil permettant de mesurer la symétrie ou l’asymétrie vestibulaire). Cet instrument vestibulaire est connecté à un logiciel informatique spécialisé appelé FramiGest. Nous avons par ailleurs fait l’acquisition d’un fauteuil rotatoire afin de réaliser les bilans nécessaires et de proposer une rééducation optimale des vertiges et des instabilités.
Les principales pathologies prises en charge par la kinésithérapie vestibulaire sont :
- Les VPPB (Vertige Positionnel Paroxystique Bénin)
- La Névrite Vestibulaire (Neuronite Vestibulaire)
- La Maladie de Ménière
- Les troubles de l’équilibre et de la marche
Le VPPB ou Vertige Paroxystique Positionnel Bénin représente l’une des causes les plus fréquentes de vertiges. Il est un bon exemple de dysfonctionnement paroxystique de l’oreille interne.
Vertige Positionnel du Canal Postérieur
Physiopathologie :
La physiopathogénie est aujourd’hui bien établie et incrimine une pathologie du canal semi-circulaire postérieur, elle même secondaire à une atteinte de la macule utriculaire. Cette lésion se caractérise par un détachement des otoconies de la macule utriculaire, lesquelles se déposent à l’endroit la plus déclive de la cavité labyrinthique, c’est-à-dire sur l’ampoule du canal postérieur. Ce détachement peut être d’origine traumatique, viral, infectieux ou dégénérative.
Les symptômes :
Le patient se plaint alors d’un vertige intense rotatoire lié aux mouvements de la tête qui présente trois particularités :
- Il se déclenche uniquement lors des changements de position de la tête dans l’espace
- Il est très violent et peut entraîner des nausées et des vomissements
- Il a une durée brève (moins d’une minute)
Diagnostic :
Les positions de la tête qui déclenchent le vertige sont le plus souvent celles de la tête en extension ou lorsque le patient se couche dans son lit le soir ou passe le matin de la position couchée à la position assise. Ce vertige se reproduit à chaque fois que le patient replace sa tête dans la même position mais il s’amenuise en intensité traduisant ainsi sa fatigabilité. L’interrogatoire est donc d’emblée très évocateur. Toutefois, seul l’examen clinique va confirmer le diagnostic.
L’examen doit être réalisé sous VNG. Il va consister en la réalisation de manoeuvres de positionnement. En pratique, le patient est assis en travers du lit et on le fait passer rapidement de la position assise à la position décubitus latéral du côté qui déclenche le vertige, tête dans le vide et tournée à 45°.
Après une latence de quelques secondes, un nystagmus et un vertige rotatoire sont déclenchés. Après une dizaine de secondes nystagmus et vertige s’arrêtent si la tête est maintenue dans la même position. La remise en position assise déclenche à nouveau un nystagmus battant cette fois en sens inverse, lequel s’accompagne aussi d’une sensation rotatoire. La répétition de ces manœuvres entraîne une diminution progressive de ce nystagmus et du vertige. Vertige et nystagmus sont donc fatigables.
Le diagnostic de ce vertige repose donc à la fois sur l’interrogatoire et sur l’examen clinique.
Evolution :
La crise de VPPB se répète durant une période de 3 semaines à un mois. Passée cette période, les crises s’estompent, ne laissant alors au patient qu’une sensation d’inconfort et surtout d’appréhension lorsqu’il reprend la position déclenchante. Souvent, le patient souffre de sensations d’instabilité, d’ébriété, souvent insupportables dans la vie quotidienne.
Traitement :
Le traitement dépend du stade évolutif auquel est vu le patient. Si le patient consulte au moment des crises ou au cours d’une rechute, le traitement repose sur des manœuvres kinésithérapiques par un kinésithérapeute formé à la rééducation vestibulaire comme votre kinésithérapeute à Bascharage. Deux types de manœuvre ont fait la preuve de leur efficacité :
- La manœuvre libératoire : Elle consiste à mobiliser vigoureusement la tête du patient de façon à déplacer la cupulo ou la canalolithiase. Cette manœuvre entraîne souvent une guérison du vertige positionnel. Elle peut être reproduite au cours d’une séance suivante si le vertige positionnel est encore présent. Si le vertige positionnel résiste à deux ou trois manœuvres bien faites, le praticien doit remettre en cause le diagnostic de VPPB. En aucun cas, ces manœuvres ne doivent être répétées de façon itérative. Or, il n’est pas rare de voir en consultation des patients ayant subi plus de 10 manœuvres et alléguant des sensations d’ébriété permanentes.
- La rééducation vestibulaire : Elle consiste en des séances permettant « d’entrainer » l’oreille interne du patient pour éviter les récidives.
Si le patient est vu à distance de la crise, un bilan de l’équilibre doit être fait sur l’équitest. Ce dernier permettra de quantifier les troubles de l’équilibre et de prescrire des séances de rééducation et une thérapie médicale efficace.
Vertige Positionnel du Canal Horizontal
Ce type de vertige positionnel est beaucoup plus rare. Il survient le plus souvent non pas lorsque le patient se couche ou se lève mais lorsque, couché, il se tourne d’un côté ou de l’autre dans son lit.
Diagnostic :
Son diagnostic repose cliniquement sur plusieurs types d’arguments :
- Il n’est pas déclenché par la mise en décubitus latéral comme celui du canal postérieur mais il survient quand le sujet est placé en position assise, tête penchée en avant, ce qui place ses canaux horizontaux dans un plan vertical
- Le nystagmus induit est horizontal et non torsionnel. Dans cette position, le sens de la phase rapide du nystagmus indique le côté malade
- Il est rarement fatiguable ;
- Sa latence d’apparition est plus brève (inférieur à 5 s) et sa durée est plus longue (20 à 60 s).
Traitement :
Le traitement repose sur la réalisation d’une manœuvre libératoire un peu différente : la manœuvre dite « en barbecue ».
La névrite vestibulaire est une cause fréquente de vertige périphérique. Elle est un bon exemple de suppression unilatérale et brutale des informations vestibulaires impliquées dans le maintien de l’équilibre et la stabilisation du regard.
Physiopathologie :
La physiopathogénie communément admise est celle d’une cessation brutale d’activité d’un nerf vestibulaire.
Il s’en suit une asymétrie brutale d’activité des noyaux vestibulaires centraux du côté lésé et intact. Les neurones vestibulaires centraux du côté de la névrite s’arrêtent de décharger alors que les neurones controlatéraux ont une activité de décharge inchangée voir augmentée du fait des voies commissurales inhibitrices qui relient certains noyaux vestibulaires comme les noyaux vestibulaires médians. Cette asymétrie d’activité est responsable du vertige rotatoire, du nystagmus spontané, des troubles de l’équilibre ainsi que des nausées et des vomissements observés au stade aigu. Progressivement et du fait de la plasticité post-lésionnelle du système nerveux central (SNC), les neurones vestibulaires centraux du côté lésé vont récupérer une activité de décharge normale alors même que les neurones du nerf vestibulaire restent silencieux. Ainsi, une nouvelle symétrie d’activité entre les complexes vestibulaires ipsi et controlatéraux à la lésion va être récupérée. Cette récupération neuronale va se traduire fonctionnellement par une disparition de la crise vertigineuse, du nystagmus spontané et par le retour à une fonction d’équilibration subnormale.
L’étiologie de l’affection semble être virale. Trois ordres d’arguments militent en sa faveur :
- Le contexte épidémiologique avec la notion de survenue par épidémies saisonnières ou familiales, l’association dans les semaines qui précèdent l’incident à une infection des voies aériennes supérieures, l’existence concomittente d’une polyneuropathie crânienne.
- Les épreuves sérologiques démontrent une protéinorachie, évocatrice d’une démyélinisation ou des anticorps antiviraux. Le virus responsable ne peut être identifié. Toutefois, le virus Herpex Simplex semble le candidat le plus probable.
- Les études histopathologiques de rochers qui ont retrouvé des lésions virales caractéristiques. A la suite d’une infection inaugurale, le virus se dissémine dans l’organisme puis reste quiescent dans les ganglions de certains nerfs crâniens dont les ganglions vestibulaires. A l’occasion d’une affection intercurrente, le virus se réveille et induit une réaction auto-immune responsable d’inflammation, d’oedème et de démyélinisation.
Une étiologie vasculaire peut dans certains cas ne pas être éliminée, notamment chez des sujets hypertendus ou présentant un terrain vasculaire.
La névrite vestibulaire se traduit par l’apparition soudaine d’un vertige rotatoire associé à des nausées et des vomissements. Fait essentiel, aucun signe auditif (surdité, acouphènes) n’est retrouvé à l’interrogatoire. Devant l’intensité de ce vertige, il n’est pas rare de retrouver le patient aux Urgences.
L’examen sous vidéonystagmoscopie retrouve un nystagmus spontané de type périphérique : il est horizonto-rotatoire, unidirectionnel et diminué en amplitude et en fréquence lors de la fixation oculaire. La phase rapide de ce nystagmus est orientée du côté de l’oreille saine. Le reste de l’examen et en particulier l’examen neurologique est normal. L’évolution est marquée par une régression de la symptomatologie vestibulaire. En quelques jours, la sensation rotatoire et les manifestations neurovégétatives vont s’amender. Il persistera une sensation de déséquilibre, qui durera quelques temps.
Le traitement immédiat repose sur la corticothérapie et les antiviraux. Dans les suites, une rééducation vestibulaire bien menée permet de favoriser le retour à une équilibration normale et une disparition des sensations d’instabilité perçues par le patient.
Dès la phase aiguë passée, le traitement repose sur une mobilisation énergique du patient. Ce dernier est levé le plus vite possible afin de favoriser la compensation vestibulaire centrale. Progressivement, les autres afférences des noyaux vestibulaires déafférentés : afférences visuelles, proprioceptives, vestibulaires controlatérales, vont se substituer aux afférences vestibulaires manquantes.
La maladie de Ménière est une maladie fréquente, qui peut être invalidante du fait du retentissement des vertiges sur la vie professionnelle, familiale et sociale du patient. Il s’agit d’un syndrome recouvrant des étiologies très diverses ayant pour expression clinique une triade symptomatique très particulière et une évolution très capricieuse.
Physiopathologie :
La physiopathogénie de cette affection décrite pour la première fois en 1861 par Prosper Menière est aujourd’hui encore discutée. Il est probable qu’elle résulte d’anomalies de fonctionnement des mécanismes de résorption de l’endolymphe, notamment de ceux qui siègent dans le sac endolymphatique. Il s’en suivrait un hydrops endolymphatique, c’est-à-dire une distension du labyrinthe membraneux qui constitue le stigmate histopathologique de la maladie.
Ce qui caractérise la maladie, à savoir la survenue de crises de vertiges et de surdité, semble causé, soit par la rupture du labyrinthe sous l’effet d’à-coups pressionnels, soit par ces à-coups eux-mêmes survenant sur des parois membraneuses élastiques, la rupture n’étant alors que secondaire.
Une deuxième série d’hypothèses fait appel à des notions d’ordre physique. La crise vertigineuse résulterait de l’hyperpression endolymphatique liée à l’accumulation progressive d’endolymphe dans un compartiment élastique. Elle modifierait la mobilité des stéréocils des crêtes ampullaires et des macules otolithiques, ce qui entraînerait une baisse de l’excitabilité des cellules sensorielles du côté malade. Elle provoquerait aussi des mouvements liquidiens ampullopètes, se propageant des cavités les plus étroites (celles des canaux semi circulaires) vers les cavités les plus larges (utriculaires et sacculaires).
Les symptômes :
- La catastrophe otolithique de Tumarkin : Cette forme clinique se caractérise par la survenue de violentes poussées linéaires vers l’avant ou vers l’arrière imprévisibles et projetant le patient par terre. Elles surviennent plus volontiers dans les formes évoluées de la maladie. Elles seraient dues à la distension brutale de la membrane otolithique et à une déafférentation aigue du système otolithique. Du fait de la gravité potentielle de ces chutes, le traitement préconisé est celui d’un traitement chirurgical radical (neurotomie vestibulaire).
- Le vertige de Lermoyez ou le vertige qui fait entendre : Cette forme clinique décrite au début en 1919, se caractérise par une amélioration transitoire de la surdité au cours d’une crise aigue de vertiges. Elle serait une variante chronologique et temporaire de la maladie de Ménière.
Diagnostic :
- Survenue d’un grand vertige rotatoire obligeant le patient à s’aliter et accompagné de signes neurovégétatifs intenses : nausées, vomissements, sueurs, diarrhée. La sensation vertigineuse dure 2 à 3 heures en laissant un patient épuisé. A la fin de la crise, le patient peut se sentir en état d’ébriété.
- Présence concomitante de signes auditifs unilatéraux :
- Acouphènes réalisant une sensation de bourdonnement, sifflement ou vrombissement, non pulsatiles.
- Surdité de type perceptif qui, au début de l’évolution, prédomine sur les fréquences graves et présente de grandes fluctuations. Elle s’associe souvent à une impression d’oreille bouchée, de plénitude ou de pression qui régresse après la crise aiguë. Au cours de l’évolution, la surdité s’aggrave, atteint l’ensemble des fréquences et se stabilise à un niveau de perte de 50 à 70dB. Cette hypoacousie s’accompagne de signes endocochléaires : atteinte de la discrimination, intolérance aux sons forts, diplacousie et distorsion sonore.
- Le terrain : les patients présentent souvent un contexte psychologique particulier comprenant un état de stress, d’anxiété, de fatigue et de chocs affectifs. Il s’agit en général de patients perfectionnistes, intelligents et obsessionnels.
- L’allure évolutive de la maladie : cette dernière est capricieuse. La fréquence des crises vertigineuses est imprévisible et varie d’un patient à l’autre. Elle peut varier de une à deux crises par semaine ou par mois ou peut ne survenir qu’une fois par an ou tous les deux ans.
Evolution :
Au fil du temps, les caractéristiques de la crise changent : le vertige devient moins violent et la sensation rotatoire est remplacée par des sensations d’ébriété, de roulis, et de tangage. Les signes cochléaires peuvent ne pas être observés au début ou restés isolés quelque temps.
Traitement :
Le traitement de la crise vertigineuse repose sur l’isolement du patient et l’administration d’un antivertigineux, d’un sédatif et/ou d’un antiémétique. Le traitement de fond vise à prévenir la récidive des vertiges. Il se subdivise en traitements conservateur ou destructeur, médical ou chirurgical, selon qu’ils conservent ou détruisent la fonction vestibulaire du côté malade.
Lorsque les médicaments ne sont pas suffisamment efficaces, les personnes atteintes peu- vent entreprendre une rééducation vestibulaire. Il s’agit d’une spécialité de la physiothéra- pie destinée aux personnes souffrant de vertiges, étourdissements et troubles de l’équilibre causés par une anomalie de l’appareil vestibulaire. Cette rééducation est encadrée par une équipe spécialisée dans les troubles de l’équilibre, travaillant en collaboration avec les mé- decins oto-rhino-laryngologistes (ORL). Plusieurs exercices peuvent être effectués, à l’aide d’un fauteuil rotatoire, de dispositifs permettant de travailler les mouvements oculaires, d’un trampoline, ou encore de lunettes spéciales (dites de Frenzel ou de vidéonystagmos- copie) permettant d’observer les mouvements des yeux.
Ces exercices permettent de rééduquer l’équilibre en renforçant les mécanismes complémen- taires qui interviennent normalement dans l’équilibre pour compenser l’atteinte vestibulaire due à la maladie de Menière.
L’équilibre dépend de l’intégration de trois types d’informations sensorielles : les entrées vestibulaires, les entrées proprioceptives et les entrées visuelles. Ces différentes informations sensorielles sont traitées au niveau des noyaux vestibulaires, du thalamus et de différentes zones corticales. Il existe une redondance des différentes informations sensorielles à chaque niveau du système nerveux central, du tronc cérébral au cortex, afin de favoriser l’équilibre au cours des mouvements de la tête et du corps dans l’espace.
Pour ce faire, on fait appel à divers procédés d’habituation, de substitution ou d’illusion sensorielles grâce à un ensemble d’exercices physiques et/ou de manœuvres instrumentales utilisant fauteuil rotatoire, rampes d’oculomotricité, générateurs de cibles optocinétiques, plate-formes de posturologie… D’après les données de la littérature, la durée moyenne d’un programme de rééducation vestibulaire s’étend de 4 à 10 semaines.
Chez les patients séniors souffrant de sensations d’instabilité, la rééducation vestibulaire diminue considérablement les plaintes et évitent les chutes qui sont, rappelons-le, la deuxième cause de mortalité après les AVC.